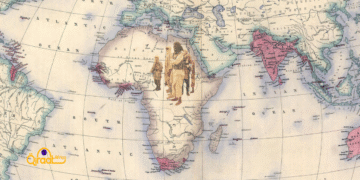Depuis la fin du mois de mai 2025, un phénomène discret mais significatif attire l’attention des observateurs : d’anciens soldats français réapparaissent en Afrique, non plus sous l’uniforme tricolore, mais au service de sociétés militaires privées.
C’est ce que révèle un rapport de Radio France Internationale (RFI), qui souligne la montée en puissance de ces contractuels opérant dans l’ombre, loin des projecteurs de la diplomatie officielle. Leur présence marque une nouvelle phase de l’influence sécuritaire française sur le continent, désormais externalisée et moins encadrée par les canaux institutionnels.
Alors que la France a officiellement réduit sa présence militaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel — notamment après les fins tumultueuses de l’opération Barkhane — ce retour indirect de ses ex-soldats brouille les lignes entre retrait stratégique et maintien d’une empreinte sécuritaire. Sous couvert de contrats privés, ces hommes interviennent dans des contextes sensibles, risquant de raviver les critiques sur une forme de néo-interventionnisme masqué.
Cette dynamique soulève des interrogations sur la cohérence de la politique française en Afrique, et sur l’impact à long terme de ces engagements officieux sur les relations bilatérales.
Car ces anciens militaires, bien qu’émancipés de la chaîne de commandement française, demeurent actifs dans des zones hautement stratégiques. Ils assurent la sécurité de sites pétroliers, protègent des diplomates occidentaux et forment des unités locales dans des pays aussi variés que la Libye, le Kenya ou encore le Burkina Faso. Leur expertise, leur formation et leur réseau renforcent leur influence dans les zones de conflit, mais contribuent aussi à maintenir, sous une forme nouvelle, la présence sécuritaire de la France sur le continent africain.
Des bases aux entreprises : L’évolution de l’engagement militaire français
La France a pris la décision de démanteler plusieurs bases permanentes à cause de l’insatisfaction de l’opinion publique, des revers opérationnels et des tensions politiques avec les gouvernements africains. Les SMP qui ont embauché ces anciens soldats sont souvent des entreprises étrangères, mais gardent des liens opérationnels significatifs avec le personnel formé en France.
Si cela assure la continuité à certains États africains cherchant de l’assistance en matière de sécurité, cela complique la volonté de la France d’adopter une stratégie de ‘discrétion’ sur le continent.
Risques stratégiques et diplomatiques
La présence en augmentation des anciens militaires dans le secteur privé présente de nombreux défis. Du point de vue diplomatique, la France est confrontée à :
Ces sous-traitants demeurent une représentation de la France pour de nombreux citoyens et gouvernements africains, peu importe leur statut professionnel.
Si une faute est commise, elle pourrait être attribuée à la France, et non à l’entreprise elle-même.
En outre, ces SMP opèrent dans un contexte de plus en plus préoccupé par la désinformation et le sentiment antifrançais, principalement nourri par les médias prorusses et les personnes liées à Wagner.
Le manque de règles juridiques et éthiques
Les SMP se trouvent dans une zone délicate du droit international. En l’absence de surveillance militaire formelle, il existe un risque accru de violations des droits humains, de corruption ou d’opérations non autorisées.
La responsabilisation est souvent difficile dans les zones de conflit africaines en raison du manque de systèmes juridiques solides. Cela pose des questions délicates pour la France :
- Est-ce qu’elle peut se distancier des actions des hommes qu’elle a formés ?
- Est-ce nécessaire de fixer des limites à l’emploi après le service ?
- Quelles sont ses obligations en cas de litige pour réglementer la carrière privée de ses anciens soldats ?
Le nouveau marché de la sécurité en Afrique
La présence d’anciens combattants français n’est pas une exception. Dans tout le continent, des pays font appel à des SMP provenant de différentes origines – Russie (par exemple, les vestiges de Wagner ou légion africaine), Turquie (Sadate), Chine (DeWe) et Émirats arabes unis – pour se procurer des services de protection, dans le cadre de la formation et du renseignement.
Certains dirigeants africains considèrent ces entreprises comme une alternative flexible aux partenariats militaires formels. Cela signifie que la France doit rivaliser pour son influence dans un écosystème complexe où le contrôle est décentralisé et les alliances transactionnelles sont essentielles.
Répercussions sur la politique étrangère française
La France pourrait ne pas être en mesure de surveiller ou de coordonner sa présence officieuse en Afrique, ce qui pourrait contredire ses objectifs plus larges en matière de politique étrangère. En soutenant publiquement la souveraineté et la transparence en Afrique, elle est souvent liée à une forme d’intervention privatisée, souvent opaque. Sa crédibilité est affectée par cette dissonance, surtout à l’heure où d’autres acteurs étendent leur influence par des méthodes tout aussi indirectes.
Options stratégiques pour Paris
Pour l’avenir, la France est confrontée à trois choix principaux :
- Ne rien faire, au risque de nuire à sa réputation et de dérive stratégique.
- Mettre en place une réglementation sur l’emploi des anciens combattants en harmonisant les outils juridiques avec les normes internationales.
- Intégrer les SMP dans une stratégie formelle, en établissant des normes d’éthique, de coordination et de surveillance.
Les avantages et les inconvénients sont présents dans chaque voie. Cependant, si une politique claire n’est pas mise en place, la France risque de perdre à la fois son terrain moral et sa clarté opérationnelle dans une région qui reste au cœur de sa position mondiale.
Conclusion
Les anciens soldats travaillant pour des SMP sont bien plus qu’une question de personnel : cela montre les tensions persistantes entre la France et son rôle en Afrique. Dans ce nouveau chapitre de son engagement, il met en avant l’héritage de l’intervention militaire, la transition vers la décentralisation et la montée de la concurrence mondiale.
Peu importe si la France opte pour la direction, la régulation ou le retrait, il est clair que l’ère des alliances tranchées et des troupes officielles est terminée. Il y a encore un champ de bataille avec des alliances floues, des acteurs privés et des influences contestées, où les anciens combattants doivent à la fois assumer le fardeau du passé et celui de l’avenir.