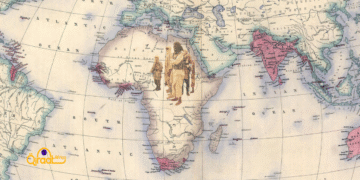Les passionnés des affaires africaines ont été nombreux à exprimer leur étonnement face aux rumeurs persistantes annonçant la fermeture du siège de « l’Association africaine » à Zamalek, au Caire. Ce lieu historique, ayant accueilli des mouvements de libération et des leaders africains, a longtemps servi de lien culturel, politique et révolutionnaire entre l’Égypte et le continent.
Bien qu’aucune annonce officielle n’ait confirmé cette fermeture, plusieurs employés, actuels et anciens, affirment qu’une décision serait prise, entraînant l’arrêt des activités après la restitution légale du bâtiment aux héritiers de son propriétaire d’origine. Cette information reste toutefois non vérifiée.
Cette situation a suscité de nombreux appels aux autorités égyptiennes pour protéger cet héritage de sept décennies, témoin d’étapes majeures dans l’histoire de l’Afrique et de l’Égypte, notamment durant les luttes pour l’indépendance et contre la ségrégation raciale.
Maison Africaine:
Le siège de la Société africaine, situé dans la Villa n°5 de la rue Ahmed Hashmat à Zamalek, ouest du Caire, porte l’empreinte de Muhammad Abd al-Aziz Ishaq, professeur de littérature à l’Université Fouad I (aujourd’hui Université du Caire) et fervent défenseur des mouvements libérateurs contre le colonialisme.
Ishaq, qui organisait dans cette villa des salons politiques dédiés aux enjeux africains, fut désigné par le cabinet du président Gamal Abdel Nasser pour accueillir les leaders de la libération à son domicile. Il fit don de la villa à l’association, alors appelée « Ligue africaine ».
Parmi ses nombreuses contributions, Ishaq proposa la création en 1953 d’une antenne de l’Université du Caire à Khartoum et tissa des liens forts avec des figures emblématiques telles que Patrice Lumumba, héros de l’indépendance congolaise assassiné peu après sa prise de fonction.
Conseiller à l’ambassade d’Égypte à Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa), Ishaq facilita également l’exfiltration clandestine des fils de Lumumba vers le Caire à la fin des années 1960. Il nourrissait également le projet ambitieux de créer la première encyclopédie africaine.
Surnommée « Maison africaine », sa villa à Zamalek reflète l’âme du continent à travers ses décorations, objets d’art et machines à écrire qui a servi aux penseurs et leaders africains dans leur lutte. Même Nelson Mandela y fit escale lors de sa visite au Caire dans les années 1990, désireux de renouer avec ce symbole historique. (1)
Création de l’Association :
Après qu’Isaac eut fait don de sa maison, l’Association africaine fut fondée au milieu des années 1950 sous le nom de « Ligue africaine » pour servir de patrie alternative aux étudiants, hommes politiques, leaders de la libération et représentants africains. Bien qu’elle reçoive une partie de ses ressources de l’État égyptien, elle en était officiellement indépendante. Son siège, situé dans un quartier de Zamalek, devint le siège de dizaines de bureaux de mouvements de libération africains et un centre culturel pour les penseurs, écrivains et étudiants qui soutenaient ces causes.
La Ligue a été créée seulement trois ans après le Mouvement des officiers libres en Égypte, qui a renversé la monarchie et déclaré une république en juillet 1952, et a coïncidé avec le début de l’engagement du Caire envers les problèmes et les préoccupations des pays du Sud global.
La Ligue était un forum d’expression politique pour les mouvements de libération africains, par le biais de canaux fournis par l’Égypte. Tandis que les politiques officielles égyptiennes se développaient, les membres de la Ligue accueillaient des militants africains, les présentaient, diffusaient leurs voix et les mobilisaient même politiquement depuis Le Caire. Elle constituait également une source de force pour les Africains victimes de persécutions politiques et souvent contraints de travailler dans la clandestinité pour surmonter les restrictions et l’isolement du colonialisme (2).
Le rôle de la Ligue comme base des mouvements de libération a progressivement évolué. Elle a été initialement créée pour accueillir les milliers d’étudiants qui arrivaient en Égypte grâce à des bourses universitaires, notamment en provenance des pays du bassin du Nil et des communautés musulmanes d’Afrique de l’Ouest.
Colonie africaine au Caire :
L’objectif égyptien derrière la création de la Ligue était d’identifier les étudiants africains impliqués dans les mouvements de libération nationale de leur pays, afin de nouer des relations fructueuses avec eux en Égypte. Certains de ces étudiants sont ensuite devenus représentants permanents, avec des bureaux au siège de la Ligue, sous la supervision de Muhammad Fayek, qui a dirigé le Bureau des affaires africaines de la présidence égyptienne de 1955 à 1966(3).
Dans son récit des objectifs de la création de la « Ligue », Fayek dit : Elle a été créée à la fin de 1955 en tant qu’organisation ayant des activités politiques et culturelles, visant à fournir toutes les facilités possibles aux bureaux politiques des mouvements de libération nationale en Afrique ; depuis la mise à disposition d’espaces de travail appropriés et leur liaison avec les agences d’État, en leur fournissant des moyens d’impression et de publication, jusqu’à l’organisation de conférences de presse et l’accueil de délégations et d’envoyés africains..
Selon Fayek, la Ligue a fourni à ces bureaux des experts et des consultants en politique et en droit, et leur a fourni les recherches nécessaires pour soutenir les dossiers de leurs pays, en plus de leur attribuer des salles pour l’organisation de séminaires et de réunions. Le bâtiment de la Ligue abritait le plus grand nombre possible de bureaux politiques, et lorsque le nombre de bureaux dépassait la capacité du bâtiment, la Ligue louait des sièges supplémentaires à proximité.
Ensemble, ces bureaux politiques publiaient un bulletin d’information intitulé « Le Magazine de la Ligue africaine », qu’ils rédigeaient eux-mêmes pour refléter les luttes de leurs peuples et expliquer leurs enjeux. Cela contribua à créer un réseau de connaissance et d’échange d’expériences et d’informations entre les mouvements africains, dans un climat consultatif et anticolonial. Cette étroite collaboration entre la Ligue et les bureaux politiques africains fut la principale raison de sa renommée mondiale.
De plus, selon Fayek, la Ligue s’efforçait de sensibiliser les Égyptiens à l’Afrique et de créer un environnement propice aux échanges entre intellectuels égyptiens et africains, qu’ils soient membres de bureaux politiques ou étudiants africains au Caire. Elle cherchait également à résoudre les problèmes de ces jeunes et à les former politiquement dans un climat révolutionnaire, et organisait des séminaires culturels réunissant des jeunes Égyptiens et Africains (4).
Station pivot :
La Ligue africaine a représenté un moment charnière dans la carrière de l’une des figures les plus éminentes de la pensée africaine contemporaine, le penseur égyptien Hilmi Shaarawy, qui a été secrétaire culturel de la Ligue avant d’être nommé chercheur à la présidence en 1959.
Au cours de son travail au sein de la Ligue, Shaarawy a vécu diverses expériences cognitives, notamment en ce qui concerne le rôle égyptien dans le soutien aux mouvements de libération africains d’une part, et dans l’opposition à la présence israélienne sur le continent d’autre part.
Shaarawy souligne dans ses mémoires que l’intérêt de confronter l’entité sioniste était au cœur de la politique égyptienne depuis qu’Israël s’est vu refuser la participation à la Conférence de Bandung en Indonésie en 1955, puis à la Conférence des peuples africains et asiatiques en 1958, avec une volonté égyptienne claire d’assiéger ses projets de pénétration dans les pays du bassin du Nil, avant même l’indépendance du Soudan ou le déplacement vers l’Éthiopie.
La prise de conscience personnelle de Mwalimu sur cette question a commencé avec son observation que les premiers mouvements de libération représentés dans la Ligue africaine venaient d’Ouganda, du Kenya, de Zanzibar et de la République démocratique du Congo, ainsi que d’Érythrée, qui était une porte d’entrée pour influencer l’Éthiopie, dans le but de protéger l’Afrique de l’Est du colonialisme traditionnel et d’Israël ; ce dernier était décrit comme pratiquant le colonialisme, puis le néocolonialisme, et enfin le sous-impérialisme… etc..
Après la fondation de l’Organisation de l’unité africaine (25 mai 1963), Shaarawy note que de nombreux représentants des mouvements de libération africains se rendirent au Caire pour solliciter son soutien. Ce furent les jours les plus glorieux de l’activité africaine au Caire. À cette époque, les bureaux des mouvements de libération à Zamalek devinrent le centre d’attention des médias égyptiens et internationaux, et l’Égypte commença à parler ouvertement de la lutte armée sans craindre d’être accusée d’ingérence (5).
Mémoire africaine :
Dans les années 1950, l’Égypte abritait des nationalistes africains venus de tout le continent. Dans les années 1960, la Ligue comptait à elle seule 24 délégations de partis et mouvements anticoloniaux, dominés par un courant nationaliste proche du régime égyptien de l’époque. Cette situation accordait aux délégations africaines une liberté de mouvement et d’accès qui n’était pas possible sous les restrictions du colonialisme et de l’apartheid.
La représentation africaine au sein de la Ligue comprenait parfois trois organisations d’un même pays, comme l’Afrique du Sud et l’Angola, en plus d’organisations qui se sont séparées de leurs entités mères, notamment : le Congrès national africain, le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola, le Mouvement pour la libération du Mozambique, l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Namibie), le Parti pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (Cap-Vert), l’Union du peuple africain du Zimbabwe, en plus des mouvements de libération d’Érythrée, du Kenya, de Somalie, de Djibouti, d’Ouganda, du Cameroun, d’Angola et d’autres(6).L’Association a permis à ces délégations de bénéficier du vaste réseau d’information égyptien. Par exemple, les allocations financières du gouvernement égyptien aux délégués de la délégation à la Conférence panafricaine ont contribué à(PAC) Un mouvement de libération nationale d’Afrique du Sud – a publié le bulletin d’information Africanist News and Views du Caire, ainsi que des articles dans les magazines de l’association African Renaissance et African League, qui présentaient la lutte contre l’apartheid comme faisant partie d’une campagne continentale contre l’impérialisme. (7).
Les délégués de la Ligue avaient également le droit d’attribuer des segments radiophoniques via la radio du Caire et, en 1962, le Parti du Congrès national africain (ANC) produit un programme hebdomadaire en anglais et en sotho, Elezwi Labantu (Voix du peuple), qui promeut un discours de résistance et de lutte armée (8).
Activisme et solidarité :
Les premières délégations africaines arrivèrent au siège de la Ligue à Zamalek, en provenance d’Afrique tropicale, après que les autorités coloniales britanniques et françaises eurent interdit l’Union du peuple camerounais (un mouvement pour l’indépendance et l’unité). À cette époque, les leaders de la libération camerounaise, menés par le leader anticolonialiste Félix Roland Momie – assassiné à Djenné en 1960 après l’indépendance de son pays – commencèrent à chercher un siège en exil (9).
En juillet 1957, Momye a établi un bureau permanent pour le Cameroun au siège de la Ligue au Caire, suivi par le nationaliste ougandais John Kalekesi, qui a dirigé le magazine Uganda Renaissance depuis le siège de la Ligue à la fin des années 1950, facilitant un dialogue national au plus fort de la prospérité du Caire en tant que centre afro-asiatique (10).
Comme beaucoup de sa génération, Kalekesi était sous une surveillance coloniale stricte, ce qui l’a poussé à quitter l’Ouganda à pied jusqu’à Juba (aujourd’hui la capitale du Soudan du Sud), puis de là par avion jusqu’au Caire, où il s’est installé au siège de la Ligue en tant que représentant du Congrès national ougandais (11).
Suivant ses traces, en 1958, un groupe de Kenyans arriva par la vallée du Nil, aspirant à étudier en Europe, mais décida plus tard d’établir un « Bureau du Kenya » au siège de la Ligue, et en 1960, ils se baptisèrent « Bureau extérieur de l’Union nationale africaine du Kenya ». (KANU) Malgré l’absence de lien officiel avec le parti KANU, le parti les a officiellement reconnus en avril 1961. La Ligue comprenait également des personnalités éminentes telles que Joshua Nkomo de l’Union du peuple africain du Zimbabwe et Vusumzi Make du Congrès panafricain, qui ont joué un rôle important dans l’activité politique au Caire. (12)
Les liens sociaux entre les militants ont contribué au lancement de campagnes de solidarité transfrontalière. Par exemple, en juillet 1959, la Ligue a organisé la « Journée de solidarité afro-asiatique avec l’Ouganda », diffusée à la radio du Caire, pour dénoncer « l’oppression et l’humiliation » sous le régime colonial. De même, après l’assassinat du dirigeant congolais Patrice Lumumba en 1961, la Ligue a organisé une manifestation de deux jours sur la place Tahrir, au centre du Caire, à laquelle ont participé des délégués du Kenya, du Rwanda et de Somalie pour dénoncer ce crime (13).
Dans ce contexte, Mwalimu Shaarawi évoque la visite d’une délégation érythréenne à la Ligue à l’été 1958 pour discuter de la position éthiopienne sur leur pays avec des responsables égyptiens et consulter des experts juridiques sur la relation fédérale avec l’Éthiopie décidée au début des années 1950. Il relate également sa rencontre avec une délégation zanzibarite (aujourd’hui partie de la Tanzanie) arrivée au siège de la Ligue pour solliciter un soutien à l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, rechercher des possibilités d’éducation pour la population de Zanzibar et faciliter le commerce du clou de girofle. La délégation a rencontré le président Gamal Abdel Nasser (14).
Cependant, Shaarawy n’a pas accueilli toutes les délégations africaines avec enthousiasme. Il a par exemple exprimé des réserves quant à la visite de George Padmore, conseiller du président ghanéen Kwame Nkrumah, à la Ligue à la fin des années 1950, en raison de ses écrits, qu’il considérait comme hostiles à l’internationalisme populiste, et de ce que Padmore avait écrit sur le « sionisme noir » dans le cadre de l’idée d’un retour en Afrique, notamment de la diaspora américaine.
Au milieu des années 1960, Shaarawi a rencontré David DuBois et sa mère, Shirley Graham DuBois, l’épouse de l’éminent intellectuel afro-américain William DuBois (une figure centrale de l’histoire afro-américaine), lors de leur visite en Égypte après la mort de ce dernier à Accra en 1963. Il a lu avec eux son poème sur « Suez et le Pharaon du Nil » qui a vaincu le « lion colonial » lors de l’agression tripartite de 1956. (15)
De la « Ligue » à l’« Association » :
L’encadrement et les ressources fournis par l’État égyptien à la Ligue africaine constituaient une arme à double tranchant. D’une part, ils lui donnaient la capacité d’agir et de soutenir les mouvements de libération, mais, d’autre part, ils la rendaient vulnérable aux conflits politiques internes de l’ère nassérienne, notamment dans ses relations avec la gauche égyptienne, ainsi qu’aux fluctuations de la politique étrangère, notamment avec l’Union soviétique et la Chine, chacune ayant soutenu à sa manière différents mouvements de libération africains.
Avec l’accession à la présidence d’Anouar el-Sadate en 1970 et son renversement des politiques de son prédécesseur, Abdel Nasser, des institutions telles que la Ligue africaine a été négligée, les opportunités commerciales afro-asiatiques en Égypte ont diminué, les personnalités éminentes de la Ligue ont été marginalisées et les militants africains soutenus par la Ligue ne se sont plus sentis les bienvenus.
Après près de deux décennies d’action révolutionnaire et de libération, la Ligue a été transférée de la Présidence de la République au Ministère des Affaires Sociales (actuellement Solidarité Sociale), et son nom a été changé en Association Africaine, organisation de la société civile. Malgré ce déclin institutionnel, son histoire témoigne de la force des réseaux populaires qu’elle a tissés parmi les Africains, tout en poursuivant ses initiatives de solidarité.
Entre 1973 et 1980, Shaarawy et ses collègues ont réussi à transformer l’association en un centre culturel et intellectuel dynamique. En 1987, Shaarawy a participé à la fondation du Centre de recherche arabo-africain, qui continue de documenter les politiques de libération transnationale en Afrique et d’établir de nouveaux cadres pour le rôle de l’Égypte sur le continent et dans les pays du Sud (16).
Avec la chute du régime d’apartheid en Afrique australe dans les années 1990, l’Association africaine a reformulé ses objectifs, se concentrant sur le renforcement des liens avec les ambassades et les diplomates africains au Caire, ainsi qu’avec les étudiants africains des universités et instituts égyptiens. Elle a également créé l’Union générale des étudiants africains en Égypte et parraine ses activités depuis 1986.
Depuis lors, l’association a organisé des cours de formation pour les professionnels des médias et les journalistes intéressés par les affaires africaines, et a ouvert sa prestigieuse bibliothèque aux étudiants africains, avec son importante collection de livres et de références africains importants.
L’association a également reçu le prix « Messager de la paix » des Nations Unies en reconnaissance de son rôle majeur dans la lutte contre les politiques d’apartheid. Elle a été accréditée comme membre observateur de l’Organisation africaine des droits de l’homme, a rejoint le Comité consultatif des organisations non gouvernementales des Nations Unies et a obtenu le statut d’organisme d’experts accrédité auprès de la Ligue des États arabes, ainsi que l’Union régionale des organisations de la société civile et l’Union régionale des associations environnementales (17).
Conclusion :
En conclusion, l’expérience de l’« Association africaine » au cours de ces sept décennies constitue un chapitre unique de l’interaction et de la force de la solidarité des peuples africains en temps de crise. Tout comme l’« Association » a embrassé la lutte révolutionnaire contre le colonialisme et l’apartheid, elle a également embrassé le dialogue intellectuel et contribué à la formation d’une conscience politique et culturelle transfrontalière.
Aujourd’hui, alors que le débat sur l’avenir de l’Association africaine et la perspective de la fermeture de son siège font rage, des voix s’élèvent pour réclamer la préservation de ce monument historique. Il s’agit de reconnaître l’importance de préserver une mémoire africaine vivante en Égypte depuis sept décennies, période durant laquelle elle a été témoin de moments clés de la libération africaine.
Elle a également contribué à la formation d’une génération de penseurs et de cadres égyptiens et africains qui ont apporté leur expertise du Caire à leurs pays respectifs. Cela reflète la nécessité de revitaliser son rôle et de renouveler son ADN, d’une manière compatible et en phase avec les défis et préoccupations communs égyptiens et africains.