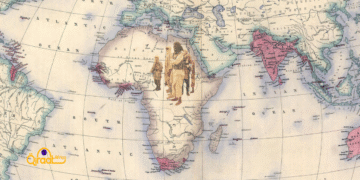L’évolution de l’ordre international et l’émergence d’acteurs non étatiques – tels que les organisations internationales, les entreprises transnationales ou les groupes armés – ont profondément transformé les dynamiques diplomatiques et la distribution du pouvoir mondial. L’État, longtemps acteur central, voit son rôle s’atténuer, tout comme sa capacité à exercer pleinement sa souveraineté ou à monopoliser les relations extérieures.
Dans ce contexte, les études sur les États fédéraux et les systèmes décentralisés s’intéressent de plus en plus à la place des entités infranationales (provinces, régions, villes) dans la sphère internationale.
Ces dernières s’impliquent désormais dans les affaires extérieures, agissent à l’échelle globale et influencent subtilement les relations internationales, un phénomène connu sous le nom de « diplomatie parallèle » ou « politique étrangère des gouvernements infranationaux ».
Au début du nouveau millénaire, les administrations locales et les entités politiques des États fédéraux ont vu leur rôle s’amplifier, tant dans les démocraties occidentales que dans les pays en développement. Animées par des intérêts politiques, économiques et culturels, elles se sont de plus en plus investies dans les affaires internationales, devenant ainsi des acteurs influents sur la scène mondiale.
La diplomatie parallèle, en facilitant la levée des obstacles et en instaurant des canaux de coordination entre les autorités nationales et régionales, peut ouvrir de nouvelles perspectives. Elle offre aux pays africains des opportunités concrètes pour soutenir leur développement et relever les défis sécuritaires et économiques, aussi bien au niveau national qu’international.
Cet article a pour objectif de mettre en lumière la notion de diplomatie parallèle, en exposant ses finalités, ses différentes dimensions, ainsi que sa mise en œuvre sur le continent africain.
À travers une présentation succincte de quelques exemples d’États fédéraux où les entités infranationales sont, au moins sur le plan constitutionnel, autorisées à s’impliquer dans les relations extérieures, l’article cherche à analyser les principaux défis sécuritaires et économiques auxquels font face les pays africains — notamment en Afrique subsaharienne — et à montrer comment la diplomatie parallèle peut constituer un levier complémentaire aux politiques étatiques pour y faire face de manière plus efficace.
Pour aborder cette thématique, l’article est structuré autour de trois axes principaux :
Axe 1 : Définition de la diplomatie parallèle, ses différentes dimensions et ses finalités.
Axe 2 : Analyse de la réalité de la diplomatie parallèle sur le continent africain
Axe 3 : La diplomatie parallèle comme levier pour stimuler le développement et répondre aux enjeux politiques et économiques en Afrique.
1. La notion de diplomatie parallèle, ses dimensions et ses objectifs
Le concept de para-diplomatie désigne l’engagement des gouvernements régionaux ou des entités infranationales dans les relations extérieures, à travers l’établissement de partenariats durables ou de contacts ponctuels avec des acteurs publics ou privés, dans le but de promouvoir des objectifs d’ordre social, économique ou culturel [1].
La diplomatie parallèle fait également référence à la conduite d’activités extérieures par les gouvernements infranationaux dans les sphères sociale, économique et sécuritaire, que ce soit dans des systèmes fédéraux ou décentralisés. Bien que ces interventions s’inscrivent souvent en parallèle à celles de l’État central, elles se distinguent par leur nature plus ciblée et fonctionnellement spécifique [2] .
Selon Thomas Jackson, deux dynamiques principales alimentent la diplomatie parallèle : d’un côté, la volonté croissante des gouvernements locaux de s’investir sur la scène internationale ; de l’autre, les efforts de l’État central pour encadrer juridiquement et politiquement cette ouverture vers l’extérieur [3].
Il ressort de ce qui précède que la diplomatie parallèle est étroitement liée à la dynamique de la décentralisation, entendue comme le transfert ou la délégation de certaines compétences et fonctions du pouvoir central vers les collectivités locales. Ce mode de gouvernance favorise l’implication accrue des gouvernements provinciaux et municipaux dans les affaires extérieures, contrairement aux systèmes centralisés qui imposent des cadres constitutionnels et juridiques rigides limitant l’action des entités infranationales au strict périmètre régional ou local.
Il note en outre que la diplomatie parallèle fonctionne en dehors des canaux diplomatiques traditionnels et peut donc être considérée comme une forme de diplomatie informelle, ce qui souligne son rôle dans la réduction des écarts entre les gouvernements infranationaux et nationaux et reflète sa nature comme une approche diplomatique plus nuancée et spécifique dans l’élaboration des politiques économiques et de sécurité.
La diplomatie parallèle se décline en plusieurs dimensions complémentaires : institutionnelle, comportementale et interactive. Sur le plan institutionnel, elle englobe l’organisation administrative propre aux entités infranationales en matière de relations extérieures, leur représentation officielle à l’étranger, ainsi que les ressources humaines et financières dédiées à ces activités. La dimension comportementale, quant à elle, concerne les actions concrètes menées par ces gouvernements, telles que les visites officielles dans d’autres pays, la participation à des conférences ou organisations internationales, ainsi que la gestion de l’aide étrangère reçue ou accordée. [4]
Les relations extérieures des entités sous-nationales dans les domaines politique, économique et culturel peuvent s’exercer de manière directe ou indirecte. Directement, ces territoires peuvent s’impliquer eux-mêmes dans l’action internationale, en concluant des accords ou traités, ou encore en envoyant des délégations et missions à l’étranger. Indirectement, leur présence à l’international peut passer par la politique étrangère de l’État central auquel ils appartiennent. Cette interaction peut se faire aussi bien avec des organisations internationales qu’avec d’autres États ou unités territoriales.
Les gouvernements infranationaux poursuivent généralement trois objectifs principaux à travers la diplomatie parallèle : politique, économique et culturel. Sur le plan politique, certains territoires cherchent à renforcer leur visibilité sur la scène internationale afin de gagner en légitimité, voire de poser les bases d’une éventuelle reconnaissance en tant qu’entité étatique, sans pour autant revendiquer ouvertement la sécession. D’autres visent à s’engager dans des dynamiques transnationales, seules ou en coopération avec des acteurs partageant des positions similaires dans d’autres pays, en particulier lorsqu’ils sont en désaccord avec les orientations politiques de leurs gouvernements centraux. [5]
Parmi les objectifs économiques de la diplomatie parallèle figurent l’introduction de technologies de pointe pour soutenir la modernisation, l’ouverture de bureaux commerciaux à l’étranger, ainsi que la recherche de débouchés internationaux pour l’exportation de produits locaux. Sur le plan culturel, les motivations incluent le renforcement de la coopération dans les domaines éducatif et culturel avec d’autres pays et régions, la promotion du tourisme, le développement des échanges étudiants, ainsi que la mise en place de partenariats de jumelage entre villes. [6].
2. La réalité de la diplomatie parallèle africaine
L’implication des gouvernements infranationaux dans les affaires internationales ne se limite plus aux seuls États occidentaux ou démocraties libérales. Ce phénomène s’est progressivement étendu aux pays en développement d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique, et ce malgré les contraintes constitutionnelles, juridiques et financières auxquelles ces États peuvent être confrontés. Dans la plupart des cas, cette participation n’est pas perçue comme une remise en cause de la souveraineté nationale ni comme une menace directe à l’autorité politique des gouvernements centraux.
Les applications pratiques contemporaines du phénomène de diplomatie parallèle se manifestent dans un certain nombre de pays africains qui ont un système fédéral ou décentralisé comme base de gouvernement, comme l’Afrique du Sud, la Somalie et le Kenya. La Constitution sud-africaine de 1994 a donné certains pouvoirs aux provinces en matière de politique étrangère. ]7[ La Constitution nationale de la République de Somalie, quant à elle, a indiqué que le gouvernement du Puntland a le droit de préconiser le règlement des conflits actuels et futurs au niveau international par le dialogue et des moyens pacifiques. En ce qui concerne les ressources naturelles, la Constitution a donné au gouvernement du territoire le pouvoir de conclure des accords avec des entités nationales ou étrangères, lui accordant des droits d’exploitation des ressources naturelles ]8[
La décentralisation de la gouvernance au Kenya a favorisé l’émergence d’un rôle accru des gouvernements provinciaux dans les affaires internationales, créant ainsi de nouveaux acteurs politiques dans la diplomatie et les relations extérieures du pays. La Constitution kényane de 2010 consacre une répartition claire des pouvoirs et des responsabilités entre les niveaux national et provincial, tout en insistant sur le respect mutuel de l’intégrité fonctionnelle et institutionnelle de chaque échelon de gouvernance. [9].
Recours à la diplomatie parallèle comme levier de développement et de réponse aux défis politiques et économiques en Afrique
Face à la montée en puissance économique et politique des gouvernements infranationaux sur le continent africain, leur implication dans les relations internationales s’impose de plus en plus comme une nécessité. À l’heure où les pays africains s’efforcent d’identifier des approches nouvelles et créatives pour stimuler le développement et répondre aux défis politiques et économiques — qu’ils soient structurels ou émergents — la diplomatie parallèle offre une voie complémentaire aux politiques menées par les gouvernements centraux.
Voici un aperçu des principaux défis que la diplomatie parallèle menée par les entités infranationales africaines pourrait contribuer à relever, en synergie avec les stratégies nationales :
1- La diplomatie parallèle comme levier de développement et de valorisation de l’identité culturelle
Dans leur effort de développement et de sauvegarde de leur identité, de leur patrimoine historique et culturel face aux influences régionales et mondiales, les collectivités locales africaines peuvent s’appuyer sur la diplomatie parallèle pour promouvoir leur richesse culturelle.
Cette forme de diplomatie permet de dynamiser les échanges culturels, de renforcer la coopération dans les domaines de l’innovation, de la formation, du transfert de compétences et de l’aide internationale entre territoires. Un exemple notable est celui de la province du Western Cape en Afrique du Sud, qui a établi un partenariat stratégique avec l’État de New York aux États-Unis pour encourager le commerce et les investissements mutuels.] 10[
Par ailleurs, la diplomatie parallèle joue un rôle important dans le renforcement de l’identité et de la culture nationales. À titre d’exemple, la ville de São Paulo au Brésil a organisé plusieurs événements et initiatives mettant en valeur l’héritage africain de ses habitants, contribuant ainsi à promouvoir la culture africaine et à créer des passerelles entre la diaspora africaine et leur pays d’origine. [11]
Dans le même esprit, la province sud-africaine du KwaZulu-Natal illustre bien l’usage de la diplomatie parallèle par les autorités locales en vue de valoriser l’identité et la culture nationales. Cette province se distingue par une volonté marquée d’internationaliser sa diversité ethnique, dans le but de renforcer sa reconnaissance aussi bien sur le plan national qu’international.
Par ailleurs, la forte présence de la communauté indienne dans cette région favorise l’exploitation des liens culturels et économiques profonds entre l’Afrique du Sud et l’Inde, ce qui constitue un levier important pour développer des partenariats et des échanges bilatéraux. [12]
2- La diplomatie parallèle comme levier dans la lutte contre le terrorisme
Accorder aux acteurs infranationaux — tels que les gouvernements régionaux et municipaux — la possibilité d’explorer des voies diplomatiques alternatives pour répondre aux enjeux sécuritaires locaux représenterait une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme et les violences armées qui affectent de nombreuses sociétés africaines, notamment en Afrique subsaharienne.
À cet égard, nous mentionnons le district de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. La violence et l’exacerbation du terrorisme armé, conséquence de l’injustice sociale et économique, de la mauvaise gouvernance et des déplacements internes, constituent une crise humanitaire qui va au-delà de la paix et de la sécurité et qui constitue une violation des droits de l’homme et des besoins fondamentaux.
Si les efforts traditionnels de lutte contre le terrorisme semblent insuffisants et n’ont pas donné les résultats escomptés, il est nécessaire de mettre en œuvre des options diplomatiques parallèles, en mobilisant des ressources, en partageant les connaissances et en renforçant la coopération entre les provinces et d’autres communautés, afin d’ouvrir des perspectives prometteuses pour s’attaquer aux facteurs qui alimentent les conflits liés au terrorisme et promouvoir une paix durable dans la province de Cabo Delgado[13].
3 – Le rôle de la diplomatie parallèle dans la lutte contre les migrations irrégulières
Le problème des migrations transfrontalières irrégulières est l’un des défis les plus importants auxquels sont confrontés les gouvernements des pays africains, en particulier en Afrique subsaharienne, et ce malgré les mesures prises par ces gouvernements pour contenir le problème de l’immigration clandestine ; Toutefois, nombre de ces mesures se sont révélées inefficaces ou sans effet réel. Il est donc essentiel que les gouvernements infranationaux assument leurs responsabilités pour faire face au phénomène de l’immigration illégale et le réduire en s’engageant dans des actions diplomatiques parallèles.
Un exemple pertinent est celui de la province sud-africaine du Limpopo. Cette expérience illustre que, bien que les gouvernements nationaux soient essentiels pour encadrer les flux transfrontaliers de migrants en situation irrégulière, leurs politiques seules montrent souvent une efficacité limitée. En revanche, en dotant les entités locales et infranationales des moyens et outils nécessaires, celles-ci peuvent jouer un rôle complémentaire aux autorités nationales et régionales dans la régulation de la migration irrégulière.
Dans ce contexte, les initiatives diplomatiques parallèles menées par le gouvernement du Limpopo ont non seulement dynamisé l’économie locale, mais aussi favorisé le développement de l’industrie régionale en s’appuyant sur la main-d’œuvre migrante. Par ailleurs, ces efforts ont contribué à atténuer les activités illégales liées aux passages répétés de la frontière par des groupes criminels et des réseaux de trafiquants, démontrant ainsi l’utilité d’une diplomatie locale proactive dans la gestion des défis migratoires. [14[
4-Le rôle de la diplomatie parallèle dans l’intégration régionale
Dans le cadre de la poursuite de l’intégration régionale par les pays africains, les gouvernements sous-nationaux ont démontré leur capacité à renforcer les efforts régionaux dans ce sens par le biais de leur diplomatie parallèle. Par exemple, les organisations internationales et les partenaires concernés dans la région de la CEDEAO ont souligné le rôle important des gouvernements sous-nationaux dans la mise en œuvre des politiques d’intégration régionale dans la région. [15 [
Les initiatives régionales lancées de manière indépendante par des acteurs sous-nationaux révèlent que de nombreux gouvernements sous-nationaux dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest ont de plus en plus tendance à établir des partenariats et des relations diplomatiques en dehors du continent africain, afin de promouvoir l’IED dans leur propre pays et d’affirmer leur rôle en tant qu’acteurs de l’intégration régionale. La participation des gouverneurs des États nigérians aux forums internationaux de développement sur des questions mondiales cruciales, telles que les changements climatiques, l’agriculture et d’autres, montre clairement que les gouvernements sous-nationaux sont de plus en plus disposés à participer aux politiques mondiales et régionales, en particulier celles qui dépassent leurs frontières nationales. [16[
5 – La diplomatie parallèle comme levier pour améliorer la sécurité des frontières en Afrique
La configuration politique de nombreux États africains met en lumière une faiblesse notable dans l’architecture institutionnelle chargée de la sécurité frontalière. Cette fragilité s’explique en grande partie par la marginalisation des provinces frontalières dans les stratégies nationales de sécurité. En conséquence, un déficit de coordination entre les niveaux de gouvernance s’installe, rendant la réponse aux menaces sécuritaires peu efficace. D’où l’importance d’intégrer la diplomatie parallèle comme mécanisme complémentaire, permettant aux entités frontalières de jouer un rôle plus actif et concerté dans la consolidation de la sécurité aux frontières nationales. [17[
Plusieurs approches peuvent permettre d’impliquer les gouvernements infranationaux dans la sécurisation des frontières, la principale étant de renforcer la participation des provinces aux structures et mécanismes de gestion frontalière, notamment par la coprésidence des commissions frontalières mixtes par les gouverneurs provinciaux et territoriaux. Par ailleurs, il est essentiel d’améliorer la coordination et l’échange d’informations entre les autorités provinciales et nationales. De même, un cadre renforcé pour la gestion des frontières internationales doit favoriser la coopération et la collaboration, afin d’exploiter pleinement le potentiel de la diplomatie parallèle pour renforcer la sécurité aux frontières africaines. Les gouvernements centraux et les administrations des régions frontalières doivent ainsi encourager une coopération et une coordination mutuelles. [18]
Conclusion
Bien que de nombreux gouvernements infranationaux africains soient engagés dans des questions de politique étrangère, comme nous l’avons noté dans la troisième section de l’article, motivés par leurs intérêts économiques, culturels et politiques, la diplomatie parallèle africaine reste plus opaque et moins influente que ses homologues d’autres pays, en Europe, en Asie et en Amérique latine, pour des raisons structurelles ou financières, ou en raison de contraintes politiques et constitutionnelles.
Il s’avère donc impératif de renforcer les débats académiques autour de la diplomatie parallèle afin d’en dissiper les zones d’ombre et d’en affirmer la singularité propre au contexte africain. Il convient en outre d’élaborer des mécanismes et approches innovantes susceptibles de permettre aux gouvernements infranationaux de ces sous-régions d’accroître leur rôle dans la conduite des relations internationales, tout en s’impliquant activement dans la résolution des enjeux et défis contemporains.
________________________
Notes et références :
[1]-Windy Dermawan, et al, “Paradiplomacy as an Instrument of Introducing Identity: Study of Aceh and Quebec”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021, available at: https://2u.pw/rN6La
[2]- Tianyang Liu, and Yao Song, “Chinese Paradiplomacy: A Theoretical Review”, sage journals, January 6, 2020, available at: https://2u.pw/1Ognk
[3]- Thomas Jackson, “Paradiplomacy and political geography: The geopolitics of substate regional diplomacy”, Geography Compass, Volume12, Issue2 (February 2018). available at: https://2u.pw/5aYWO
أيمن إبراهيم الدسوقي، “الدبلوماسية في عصر العولمة بين الاستمرارية والتغير”، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مج20، ع1، (2019)، ص110 [4]
[5]- Michael Keating, Paradiplomacy and Regional Networking, “Forum of Federations: an International Federalism”, Hanover, October 2000, PP. 1-2. available at: https://2u.pw/liKUj
أيمن إبراهيم الدسوقي، وسلطان الربيعي، “في ظلال كوب 28: الدبلوماسية-الموازية الخضراء وتغير المناخ”، مركز تريندز [6]- للبحوث والاستشارات، 14 مايو 2023م، متاح على : https://2u.pw/rbk7W
[7]- Ohiocheoya Omiunu, “Contemporary expressions of the foreign relations of subnational governments in Africa: Introduction to the Special Section”, Regional & Federal Studies, Volume 34, Issue 3 (2024). available at: https://2u.pw/HFjde
[8]- AbiShakur Mohammad Warsam, “Paradiplomacy in Post-Conflict Federal States: A Case Study of Somalia”, Master’s thesis, Institute of Graduate Studies, Istanbul Kultur University, 2024, P. 95.
[9]- Sophie Shisanya Amutavy, “Paradiplomacy in Kenya: A Case of devolved system of Governance”, A Research Report, United States International University – Africa, 2018, P. vi. available at: https://2u.pw/fFLdO
[10]- Eric Muhia, “Paradiplomacy: A New Tool for African Development”, Diaspora Digital News, June 6, 2023, available at: https://2u.pw/KdLvt
[12]- Nolubabalo Magam, “Paradiplomacy in South Africa: the role of interest and identity in the international relations of KwaZulu Natal province”, PhD thesis, University of KwaZulu-Natal, the School of Social Science, 2024, PP. 121- 122.
[13]- Ndzalama Cleopatra Mathebula, “The Potential of Paradiplomacy as a Counter-terrorism Strategy in Cabo Delgado”, Accord, December 20, 2024, available at: https://2u.pw/uT3Pb
[14]- Samuel Kehinde Okunade, “Addressing irregular migration into South Africa: Paradiplomatic efforts of subnational governments in the Limpopo Province”, South African Journal of International Affairs, Volume 31, Issue 4 (2024). available at: https://2u.pw/aNoQ4
[15]- Samuel Kehinde Okunade, “Paradiplomacy In West Africa: Exploring The Role Of Subnational Governments Toward Regional Integration And Development”, Journal of African Union Studies, Vol. 13, No. 3 (December, 2024), PP. 10-11.
[17]- Gilbert Kipyegon Ng’eno, and Odote Peterlinus Ouma, “Para-Diplomacy and Border Security: A Kenyan Perspective”, American Journal of International Relations, Vol. 8, Issue. 1 (2023), P.6.