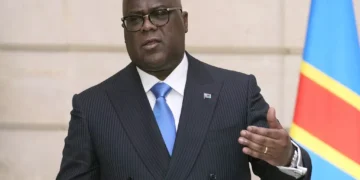Auteur : Pr/Dr. Hamdy A. Hassan | Traduit de l’arabe par : Sidi-M. OUEDRAOGO
Le Niger est devenu le troisième pays de la région du Sahel, en moins de trois ans, à être témoin d’un coup d’État militaire après le Mali et le Burkina Faso voisins. Dans les trois pays, des insurrections violentes ont affaibli des gouvernements fragiles, provoqué la colère des militaires et déclenché de graves chocs économiques sur les populations de certains des pays les plus appauvris du monde.
Il est à noter que le renversement des présidents élus s’est accompagné de manifestations anti-françaises et pro-russes. Les manifestants affirment que la France, l’allié traditionnel du pays, n’a pas réussi à les protéger des groupes armés, alors que la Russie serait un allié plus apte.
Au Mali, par exemple, un coup d’État militaire en 2020 a entraîné un changement radical dans les relations avec la France, qui a retiré ses forces l’année dernière lorsque le Conseil militaire de transition les a remplacées par les forces paramilitaires russes de Wagner. La France s’est également retirée du Burkina Faso après deux coups d’État l’année dernière, le groupe militaire au pouvoir ayant adopté une ligne nationaliste populiste.
Ces retraits ont incité la France à reconfigurer sa stratégie anti-terroriste au Sahel, qui dure depuis une décennie, en concentrant ses efforts au Niger, où elle dispose de 1 500 soldats et d’une importante base aérienne près de Niamey. Le récent coup d’État est venu plonger la France et l’Occident dans un labyrinthe de calculs stratégiques, dans le but d’empêcher la chute du plus important allié occidental dans la région. Cet article tente de discuter des répercussions les plus importantes du coup d’État au Niger sur les États-Unis, la France et les pays européens d’une part, et les pays voisins d’autre part.
Le retour du phénomène des putschs en Afrique:
Il semble que la vague de coups d’État militaires qui a balayé l’Afrique dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier est revenue dominer le cours des événements africains une fois de plus. Le continent a connu sept coups d’État militaires depuis 2020 au Mali (deux fois) et au Burkina Faso (deux fois), et un coup d’État chacun en Guinée, au Tchad et au Soudan.
Il existe également des cas dans lesquels des dirigeants élus sapent les freins et contrepoids démocratiques au pouvoir pour consolider le pouvoir et prolonger leur mandat. Ce n’est un secret polichinelle que lorsqu’un coup d’État militaire est toléré dans un pays, il ouvre la porte à des groupes militaires cherchant le pouvoir ailleurs pour faire de même. C’est tout simplement la théorie de la contagion du putsch..
Il est noté dans le phénomène récent des coups d’État militaires qu’ils provenaient d’officiers menant la garde présidentielle ou d’unités des forces spéciales au lieu des commandants militaires au sommet de la hiérarchie du commandement militaire. Ces unités d’élite reçoivent souvent une formation spécialisée, de l’équipement et des salaires pour améliorer leurs capacités. Au fil du temps, cependant, certaines de ces unités se sont politisées et se sont habituées à leur espace privilégié près du centre du pouvoir. Cette politisation est susceptible d’éroder la nature apolitique déclarée des militaires, leur permettant à terme de prendre le pouvoir pour eux-mêmes en tant que protecteurs de la nation.
Les putschistes, y compris le récent coup d’État au Niger, justifient généralement leurs actions sur la base de griefs réels ou perçus en matière de sécurité et de développement. L’image stéréotypée du coup d’État en Afrique était de nettoyer la maison de la corruption, et cela s’incarne peut-être dans l’apparition du ministre des Finances dans le gouvernement du président déchu, Muhammad Bazoum, pleurant devant les écrans de télévision, car le nouveau conseil militaire du Niger lui a ordonné d’enregistrer la valeur de l’argent volé au Trésor public dans les 48 heures, sinon il risquait la mort par peloton d’exécution.
Cependant, les conseils militaires récents en Afrique n’ont pas été réformistes. Les événements extrémistes violents au Mali et au Burkina Faso, par exemple, ont triplé depuis les coups d’État. Aucun de ces conseils militaires n’a tenté sérieusement de ramener leur pays à un régime démocratique. Au lieu de cela, ces conseils militaires se sont concentrés sur la prise et le maintien du pouvoir comme une fin en soi.
Les revendications du Conseil national pour la protection de la patrie, dirigé par le général Abd al-Rahman Chiani, plus connu sous le nom d’Omar, sont liées à la détérioration de la situation sécuritaire et à la mauvaise gestion économique et sociale. Cela contredit peut-être ce qu’a annoncé l’armée nigérienne il y a plusieurs mois lorsqu’elle a affirmé que le pays ne connaissait pas de graves crises sécuritaires et institutionnelles comme celles que connaissent d’autres pays du Sahel. Officieusement, une autre hypothèse est que le président Bazoum aurait voulu réorganiser son dispositif sécuritaire, ce qui aurait pu conduire à la destitution du général Chiani.
Nous sommes dans un contexte vraiment différent du précédent coup d’Etat de 2010 au Niger. A l’époque, il y avait un président qui venait d’adopter un amendement constitutionnel lui permettant de rester au pouvoir. Cette fois en 2023, il n’y a aucune tentative de maintenir Muhammad Bazoum au pouvoir ni même d’essayer d’étendre ses pouvoirs, car le président est arrivé il y a seulement deux ans grâce à la légitimité des urnes et le processus électoral a été décrit comme crédible et fiable.
Le déclin de l’influence française et européenne :
Force est de constater que la France et l’Union européenne perdent leur allié le plus fidèle dans la région du Sahel. Depuis plus de dix ans, la France et l’Union européenne ont misé notamment sur le Niger. De plus, le Niger a servi de porte de sortie sûre pour l’opération Barkhane. Niamey accueille la quasi-totalité des bases des forces antiterroristes internationales au Sahel.
Les États-Unis, par exemple, ont dépensé environ 500 millions de dollars depuis 2012 pour aider le Niger à améliorer sa sécurité. L’armée allemande est également présente au Niger dans le cadre de la mission de lutte contre l’instabilité et la violence terroriste de l’Union européenne, tout comme l’armée française, qui s’est retirée du Mali.
Les Européens sont donc très préoccupés par la situation au Niger, pays qu’ils ont approché pour mener la guerre contre le terrorisme dans la région du Sahel sur fond de tensions avec le Mali et le Burkina Faso.
Cependant, que représente concrètement le Niger pour des pays comme la France ou encore l’Allemagne et l’Union européenne plus largement ? Et quel avenir pour la coopération militaire avec Niamey à la lumière de ces conditions putschistes?
Le Niger est le carrefour des routes migratoires entre l’Afrique de l’Ouest et la mer Méditerranée. Ainsi, la fragilité de la frontière libyenne a fait du Niger un avant-poste de la politique anti-immigration de l’UE au sud, autant que la Turquie à l’est. Le Niger est également devenu un bastion de la démocratie dans une région stratégiquement disputée qui s’étend du Sahel au Sahara à travers l’Afrique du Nord, une région en proie à une série de coups d’État militaires et d’insurrections armées.
Le Niger est également confronté à des vents contraires effrayants qui s’aggravent mutuellement : le changement climatique, le terrorisme et l’absence d’un avenir sûr pour une population en croissance rapide qui n’a déjà pas assez d’emplois. Cependant, il y a une vague de populisme contre l’Occident, la France en premier lieu, les considérant comme faisant partie du problème et non de la solution, cherchant à obtenir de l’uranium au Niger et à faire face à d’éventuelles vagues migratoires. Peut-être la décision du Conseil militaire de transition au Niger de cesser d’exporter de l’uranium soutient-elle une telle interprétation.
Il est possible que Moscou puisse récolter les fruits de la frustration face à l’exploitation occidentale des ressources africaines, comme elle l’a fait auparavant au Mali lorsqu’elle a soutenu l’autorité militaire de transition depuis 2020. Cela conduit souvent à un déclin de l’influence occidentale.
Les enjeux de la présence américaine :
Ce n’est un secret pour personne que le Niger en particulier est vital pour les efforts américains de lutte contre le terrorisme en Afrique pour plusieurs raisons :
1- Emplacement stratégique : L’emplacement géographique du Niger est stratégiquement important pour les opérations américaines dans la région. Il partage des frontières avec des pays confrontés à d’importantes menaces terroristes, comme le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Ces zones ont connu une augmentation significative des activités terroristes, faisant du Niger un lieu important pour le lancement d’opérations antiterroristes.
2- Il abrite des bases militaires américaines : Le Niger est l’un des rares pays de la région à avoir accepté d’accueillir des bases de drones américains et des forces spéciales américaines. On estime qu’il y a environ un millier de militaires et de militaires américains au Niger, et les États-Unis ont fourni une assistance et une formation en matière de sécurité aux institutions militaires du Niger. La présence militaire au Niger permet aux États-Unis d’exercer une surveillance et de recueillir des renseignements sur des groupes armés tels que Boko Haram et les affiliés de l’Etat islamique opérant dans la région.
3- Participation aux opérations de contre-terrorisme : Le Niger coopère activement avec les États-Unis dans les efforts de contre-terrorisme contre les groupes extrémistes. L’armée et le gouvernement du pays se sont engagés dans des opérations conjointes et le partage d’informations, ce qui était crucial pour perturber et contenir les activités terroristes. Par exemple, le général Moussa Salou Bermo, commandant des forces d’opérations spéciales au Niger et l’un des meneurs du récent coup d’État contre le président Mohamed Bazoum, a été formé par l’armée américaine. Ce qui est peut-être matière à réflexion, c’est la participation de militaires formés par les États-Unis à 11 coups d’État en Afrique de l’Ouest depuis 2008.
4- Gouvernement de soutien : Le gouvernement du Niger, sous la direction du président Mohamed Bazoum, a démontré son engagement à lutter contre l’extrémisme violent. En retour, les États-Unis ont soutenu les efforts de Bazoum en fournissant une aide économique et en louant les initiatives du pays en matière de programmes de démobilisation, de désarmement et de réintégration visant à lutter contre le terrorisme.
5- Stabilité régionale : Le terrorisme dans la région du Sahel constitue une menace non seulement pour les pays touchés mais aussi pour la stabilité régionale. L’instabilité dans un pays peut avoir des répercussions sur les pays voisins, entraînant des crises de réfugiés et des problèmes de sécurité croissants. En soutenant les efforts de lutte contre le terrorisme au Niger, les États-Unis visent à empêcher la propagation de l’extrémisme et à promouvoir la stabilité dans l’ensemble de la région africaine.
6- Empêcher l’expansion de l’influence des groupes de mercenaires russes : Les États-Unis sont préoccupés par la présence et les activités du groupe de mercenaires russes Wagner dans la région. Les États-Unis ont remarqué que partout où Wagner opère, l’instabilité et les conséquences négatives ont tendance à augmenter. Ainsi, en maintenant un partenariat fort avec le Niger, les États-Unis visaient à empêcher le pays de se tourner vers Wagner pour une assistance sécuritaire, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les intérêts américains et la stabilité régionale.
Le putsch et la crise des pays voisins :
Le récent coup d’État au Niger imposera certainement un fardeau supplémentaire au Sahel et à l’Afrique de l’Ouest, qui constituent un complexe sécuritaire très complexe et entrelacé. En conséquence, l’instabilité en République du Niger affectera les pays voisins de quatre manières importantes.
Premièrement, il est probable que des groupes terroristes extrémistes, des réseaux criminels et d’autres éléments déstabilisateurs utiliseront tout vide sécuritaire créé par une telle instabilité pour annuler tous les gains que le Niger et d’autres pays du Sahel de la sous-région ont réalisés depuis une décennie pour contenir ces groupes.
Il est indéniable que le coup d’État au Niger peut représenter un facteur d’instabilité dans les pays voisins, ce qui aura des conséquences désastreuses pour la région et le Nigeria en particulier. Le chaos croissant et le malaise total que l’on peut observer au Niger pourraient exacerber un pays déjà aux prises avec l’extrémisme, les attaques terroristes de Boko Haram et des militants de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, et l’aggravation des difficultés économiques.
Le président déchu était connu pour sa lutte acharnée contre les groupes terroristes dans son pays et sa sous-région. Son renversement et l’instabilité qui en résulte pourraient créer un espace permettant aux groupes terroristes au Niger de se repositionner et de renforcer leurs actions contre les États de la sous-région.
Deuxièmement, les pays voisins sont susceptibles de supporter le poids de la crise des réfugiés au Niger. La République du Niger, qui sert déjà de point de transit pour les migrants et les réfugiés, a un taux de jeunesse élevé et le taux de natalité le plus élevé au monde. Toute déstabilisation du pays entraînera des mouvements massifs de réfugiés vers les pays voisins à travers des frontières poreuses.Avec le changement climatique et les conflits, il est normal que les agriculteurs et les éleveurs migrent, ce qui exacerbe et intensifie les affrontements très violents entre agriculteurs et éleveurs..
Troisièmement, la crise au Niger constituera une menace réelle pour la croissance et l’approfondissement de la démocratie dans la sous-région ouest-africaine. L’élection du président déchu a marqué le premier transfert de pouvoir démocratique dans un pays qui a connu quatre coups d’État militaires depuis l’indépendance de la France en 1960. Cela annulerait tous les gains réalisés en conséquence. En effet, sept pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel sont sous régime militaire. L’expérience fragile du Niger souligne la vulnérabilité à un régime anticonstitutionnel dans d’autres démocraties de la région.
Le militarisme et les conseils qui dirigent de nombreux pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel n’inspirent pas confiance et peuvent être perçus comme réactionnaires par d’autres parties prenantes. Chaque coup d’État réussi fournit un signal ou un encouragement aux activités déstabilisatrices telles que les insurrections, l’immigration illégale et les groupes extrémistes.
Quatrièmement, le coup d’État au Niger est un test du leadership du Nigéria en Afrique de l’Ouest. En plus d’influencer directement le Nigeria en tant que voisin, cela affectera son statut de leader régional et continental. La façon dont le Nigeria, en tant que puissance régionale, s’engage et interagit avec son voisin, déterminera comment il maintiendra son statut de puissance continentale.
Cela se reflète peut-être dans les décisions du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 30 juillet à Abuja, qui vise à supprimer le conseil militaire. Cela comprend l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne, la fermeture des frontières aériennes et terrestres et des sanctions financières, sans exclure le recours à la force.
En guise de conclusion…
Le récent coup d’État militaire en République du Niger rappelle aux dirigeants africains de tirer de précieuses leçons de cette évolution malheureuse. La présence de certains groupes populaires soutenant le coup d’État souligne le besoin urgent pour les dirigeants de s’attaquer aux problèmes économiques et de travailler à la construction d’une économie nationale plus forte.
Il est crucial que le président Bola Tinubu et les autres dirigeants de la CEDEAO mènent une enquête approfondie sur les circonstances qui ont conduit au coup d’État militaire. Une telle enquête fournira des informations précieuses et guidera l’organisme d’intégration régionale dans la prise de mesures appropriées. Tout en traitant la situation, il est nécessaire d’éviter une action militaire précipitée en République du Niger.
Au lieu de cela, d’autres mesures diplomatiques et pacifiques devraient d’abord être soigneusement examinées et épuisées. Le statut du Niger en tant que pays largement enclavé et pauvre doit également être pris en compte au moment de décider des mesures appropriées. Les dirigeants doivent écouter les voix des gens, comprendre le contexte de pauvreté et de dénuement qui prévaut dans la région et tenir compte du sort des pauvres lorsqu’ils déterminent leur ligne de conduite.
Il y a un héritage de l’héritage colonial et de l’exploitation des ressources du pays dans le cadre d’une division internationale du travail injuste. En conséquence, en traitant la situation à travers une vision africaine globale, en se concentrant sur le développement durable et en tenant compte de la population pauvre, les dirigeants africains peuvent travailler ensemble pour parvenir à la stabilité, au progrès et à l’amélioration des conditions du peuple nigérien et de la région au sens large. D’une part, et éviter de tomber dans le piège du nouveau labyrinthe géostratégique entre l’Occident, la Russie et la Chine d’autre part.