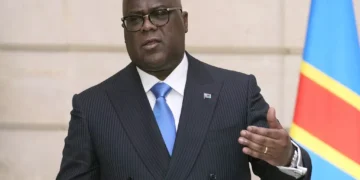Cet article aborde le retrait sans précédent du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et explore ses multiples conséquences. La décision, annoncée par les dirigeants militaires de ces pays, semblait être motivée par des préoccupations concernant une nouvelle forme de néo-colonialisme de la part de la CEDEAO, soulevant des questions sur la souveraineté et les dynamiques régionales.
Quatre éléments clés sont examinés: le contexte historique ayant conduit au retrait, les conséquences économiques, les implications géopolitiques et les possibles réorganisations des alliances régionales.
Le contexte historique
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été créée en 1975 dans le but de promouvoir l’intégration économique et de préserver la paix dans la région de l’Afrique de l’Ouest. L’organisation est composée de 15 pays de la région de l’Afrique de l’Ouest. La République islamique de Mauritanie s’est retirée de ce groupe en 2000. De plus, le Royaume du Maroc a soumis une demande d’adhésion à l’organisation en 2017, mais sa demande n’a ni n’était acceptée ni rejetée jusqu’à présent.
La CEDEAO a activement participé aux efforts de résolution des conflits et de médiation. Elle est intervenue dans diverses crises et conflits politiques pour promouvoir la paix et la stabilité. Des exemples notables incluent les interventions au Libéria et en Sierra Leone pendant les guerres civiles des années 1990, où la CEDEAO a joué un rôle crucial dans la conclusion d’accords de paix.
L’organisation a adopté le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance en 2001, qui définit les principes et lignes directrices pour renforcer la démocratie et la stabilité politique parmi les États membres. Le protocole comprend des dispositions relatives à la diplomatie préventive, à la résolution des conflits et aux sanctions en cas de changement inconstitutionnel de gouvernement.
La CEDEAO a imposé des sanctions aux États membres confrontés à des crises politiques, des changements inconstitutionnels ou des coups d’État militaires. Ces sanctions peuvent inclure des interdictions de voyage, le gel des avoirs et des restrictions commerciales, et elles peuvent même inclure une intervention militaire, une mesure que la communauté a envisagée après le coup d’État au Niger en 2023 mais n’a pas mise en œuvre.
Ces sanctions et pressions ont poussé le Niger, le Mali et le Burkina Faso à se retirer de l’organisation après les récents coups d’État survenus dans ces pays, ce qui a représenté un changement majeur dans le paysage géopolitique régional. Ce retrait, motivé par les tensions résultant des coups d’État militaires et des sanctions ultérieures imposées par la CEDEAO, reflète le pic des relations tendues.
Répercussions économiques
Les implications économiques du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont profondes et multiples. Les sanctions imposées par la CEDEAO en réponse aux coups d’État ont porté un coup dur aux économies de ces pays. La fermeture des frontières, les restrictions financières et commerciales ont entraîné une contraction économique importante, avec des sanctions monétaires sévères pour le Mali qui ont affecté les opérations de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Pour le Burkina Faso, qui n’a pas été soumis à des sanctions économiques de la part de la communauté, à l’exception de la suspension de ses activités au sein des institutions de l’organisation, et pour le Niger, toutes les transactions financières et commerciales avec les États membres ont été suspendues, les frontières terrestres et aériennes ont été fermées, et tous ses actifs dans les banques des États membres ont été gelés. Le Nigeria, qui préside l’organisation, a coupé l’électricité au Niger, fournissant environ 70 % de ses besoins.
Cependant, ces sanctions ont rapidement eu des répercussions sur le Nigeria lui-même, les États du nord du Nigeria et les hommes d’affaires ayant été touchés en raison de la détérioration de leurs marchandises restées bloquées aux frontières. La cessation du commerce entre les deux pays a entraîné une hausse des prix de nombreux produits de base au Nigeria, en particulier le riz. Les répercussions ont également touché le Ghana, qui a connu une grave crise de l’oignon en raison de ces sanctions, 70 % des oignons consommés provenant du Niger.
Ces sanctions ont également eu de graves répercussions sur le Niger, en particulier en raison des coupures de courant, qui auront des répercussions importantes, notamment économiques. La fermeture a également entraîné une augmentation des prix des produits de première nécessité dans un pays où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Bien que le retrait puisse atténuer ces sanctions, il pose de nouveaux défis. L’interconnexion des économies de l’Afrique de l’Ouest signifie implicitement que la séparation de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pourrait perturber les voies commerciales et les partenariats existants, ce qui affecterait des secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et les services.
Répercussions géopolitiques
Les répercussions géopolitiques du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont significatives. Avant leur retrait de la CEDEAO, ces trois pays se sont retirés du G5 Sahel, composé du Tchad, de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ce groupe a été créé en 2014 avec le soutien français pour lutter contre les groupes jihadistes dans la région du Sahel africain.
Le Mali a été le premier à se retirer de ce groupe en mai 2022, suivi par le Burkina Faso et le Niger en décembre 2023. Ce retrait a été en réponse aux sanctions imposées par la CEDEAO à ces pays et pour affirmer leur sortie de l’influence française. Cette décision a conduit la Mauritanie et le Tchad à annoncer également leur intention de quitter cette organisation.
Le retrait de ces pays aura des répercussions majeures sur la région du Sahel, que ce soit en termes de coordination entre ces pays pour lutter contre les groupes jihadistes présents dans la région ou en termes d’influence française et de présence militaire. Les déclarations du Burkina Faso et du Niger ont souligné que l’une des principales raisons du retrait était la manipulation de Paris de l’organisation et sa tentative d’imposer sa présence militaire à travers elle dans la région du Sahel.
Après s’être retirés du G5 Sahel, ces pays ont également quitté la CEDEAO, ce qui aura des répercussions stratégiques majeures, que ce soit sur le plan économique comme mentionné précédemment, ou même sur le plan sécuritaire. Par exemple, le Niger est le plus grand pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et partage des frontières avec 7 pays.
Tout comme les répercussions économiques, les implications sécuritaires sont également très importantes, car tous les pays partageant des frontières avec le Niger sont confrontés à un problème intensif de militantisme jihadiste, avec la plupart des groupes concentrés dans les régions de ces pays adjacents au Niger (nord du Nigeria, nord du Bénin, est du Burkina Faso, est du Mali, sud de la Libye, ouest du Tchad, sud de l’Algérie).
Cela affectera la coopération sécuritaire au sein de l’organisation régionale de la CEDEAO et même la coopération au sein de l’Union africaine sur de nombreux dossiers.
Remodeler les alliances régionales
Après la menace de la CEDEAO d’intervenir militairement pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé une nouvelle alliance entre eux sous le nom d’Alliance des États du Sahel » (AES), qui est un accord de défense commune entre les pays avec une forte connotation militaire et sans dimension de coopération économique.
Malgré cela, les transactions entre ces pays se font toujours en Franc CFA, ce qui montre qu’ils restent sous l’influence de la CEDEAO et de la France, et que le processus de libération de ces pays de l’ombre française n’est pas encore complet, malgré leurs déclarations.
Cependant, au début du mois de février, des rumeurs ont commencé à circuler sur un accord entre les trois parties concernant une monnaie unique appelée « monnaie du Sahel », qui devrait être annoncée bientôt après que les experts financiers des trois pays aient terminé l’étude de ce sujet.
Certains pays de l’Afrique de l’Ouest pourraient également se joindre à ce projet de nouvelle monnaie pour se libérer de la domination du Franc CFA, qui est imprimé par la France et dont les réserves en espèces sont à Paris. La création de l’Alliance des États du Sahel et le retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) indiquent un changement dans les alliances régionales.
Conclusion
En conclusion, la formation de l’Alliance des États du Sahel (AES) entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en réponse à la menace d’intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir, montre un changement dans les alliances régionales en Afrique de l’Ouest. Malgré cela, les transactions se font toujours en Franc CFA, montrant ainsi une dépendance continue à la France et à la CEDEAO.
Cependant, l’éventuelle création d’une monnaie unique appelée « monnaie du Sahel » pourrait marquer une étape vers l’indépendance économique et la fin de l’hégémonie du Franc CFA dans la région. Le processus de libération des pays de l’influence française semble en cours, mais il reste à voir comment cette évolution affectera les rel